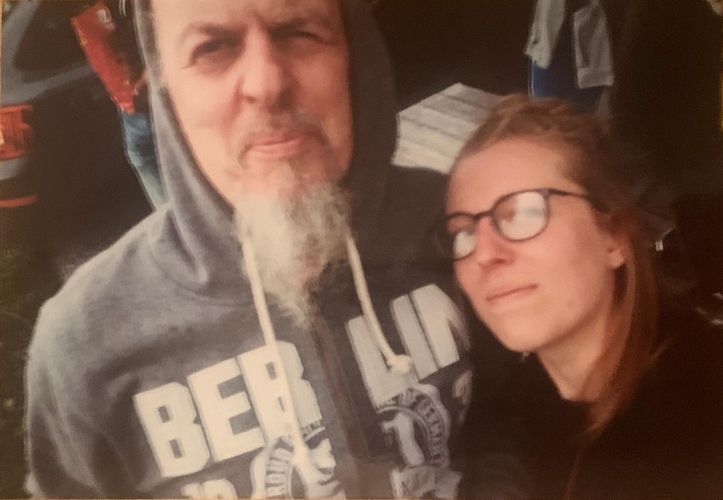Le saut dans le vide
Les personnes placées ou internées contre leur volonté n’étaient pratiquement pas préparées à la vie hors de l’institution. Pendant longtemps, elles n’ont que rarement été aidées lors de leur transition vers une vie autonome. Et aujourd’hui encore, l’assistance dont elles bénéficient reste insuffisante.
Une épée de Damoclès sur le bonheur
Les personnes internées ou placées avaient très peu de possibilités d’influer sur la fin de la mesure.
Si cette dernière se terminait souvent à la majorité (fixée à 20 ans jusqu’en 1996), devenir majeur·e ne marquait pas toujours la fin des interventions des autorités. En effet, toute personne qui, selon ces autorités, ne menait pas une vie « convenable » risquait de subir de nouvelles mesures. Par ailleurs, les personnes libérées ne bénéficiaient que rarement de prestations de soutien dignes de ce nom et la voie vers une vie indépendante était souvent un chemin semé d’embûches. À tel point que certaines, incapables de surmonter leur vécu, choisissaient le suicide...
Quand un soutien fait toute la différence
Les personnes qui aident d’autres personnes sans s’interroger sur leur passé peuvent réorienter la suite du parcours de vie de ces dernières. Grâce à elles, certain·e·s interné·e·s ont trouvé le soutien nécessaire pour réussir leur vie.

Lors du rigoureux hiver de 1963 (la dernière fois que le lac de Zurich a gelé), le pasteur Ernst Sieber installa un refuge de fortune dans un ancien bunker pour accueillir les sans-abri. Photographe : Jules Vogt
Le pasteur zurichois Ernst Sieber a commencé dans les années 1960 à s’occuper des personnes marginalisées. Ce « travailleur de rue » et « pasteur des sans-abri » a notamment fondé le Christuszentrum, une communauté accueillant des jeunes en difficulté, dont un bon nombre avait grandi en institution. Mario Delfino en a été le premier habitant.
Le manque de préparation à la vie, un problème aujourd’hui encore
Le manque de soutien fourni aux personnes placées ou internées afin qu’elles puissent mener leur propre vie hors de l’institution reste un problème.


Aujourd’hui, la majorité est fixée à 18 ans : à cet âge, les jeunes qui ont grandi dans un foyer ou dans une famille d’accueil cessent d’être soutenus par l’État. En devenant majeurs, ils acquièrent des droits, mais aussi des obligations. Du jour au lendemain, ils doivent faire face à de nouvelles responsabilités : logement, travail, argent, il leur faut tout à coup tout gérer. Une association de jeunes adultes n’ayant pas grandi dans leur famille d’origine a créé un réseau d’entraide (« Care Leaver ») pour les soutenir dans cette étape cruciale.
Nous prenons la parole dans ce film
Une épée de Damoclès sur le bonheur
Les personnes internées ou placées avaient très peu de possibilités d’influer sur la fin de la mesure.
Si cette dernière se terminait souvent à la majorité (fixée à 20 ans jusqu’en 1996), devenir majeur·e ne marquait pas toujours la fin des interventions des autorités. En effet, toute personne qui, selon ces autorités, ne menait pas une vie « convenable » risquait de subir de nouvelles mesures. Par ailleurs, les personnes libérées ne bénéficiaient que rarement de prestations de soutien dignes de ce nom et la voie vers une vie indépendante était souvent un chemin semé d’embûches. À tel point que certaines, incapables de surmonter leur vécu, choisissaient le suicide...
Une étape cruciale : la sortie
Le parcours vers une vie autonome dépendait de l’opinion de quelques responsables : dans les institutions, le directeur, le « père-directeur » ou la mère supérieure disposait de vastes pouvoirs pour influencer la date de la libération et ses éventuelles conditions. C’est en effet sur leurs évaluations ainsi que sur des expertises psychiatriques que se fondaient les services placeurs et les tuteurs·trices pour décider d’une éventuelle sortie.
Ces évaluations tournaient surtout autour de la question de savoir si l’interne avait fait des « progrès » depuis son entrée et s’il avait réussi sa mise à l’épreuve. En d’autres mots : s’il s’était soumis au régime de vie imposé dans l’institution. La direction des institutions et des établissements disposait donc d’un pouvoir très étendu. Quelques organisations privées s’assuraient aussi le droit de décider du sort des enfants et des jeunes placés : elles poussaient les parents à signer une convention de cession en proposant en contrepartie de prendre en charge les frais de pension des enfants.
Le flou dans la définition des critères de libération favorisait les décisions arbitraires. Il a fallu attendre l’après-guerre pour qu’on limite le pouvoir des directions d’institution et que l’on fasse appel à des commissions d’expert·e·s pour évaluer les internes.
La sortie de l’institution n’était souvent pas synonyme de liberté absolue, puisque de nombreux anciens interné·e·s étaient mis sous « patronage » : ils étaient surveillés et suivis. Dans de nombreux cantons, c’était un ou une fonctionnaire qui assumait cette tâche. Le patronage constituait donc une intervention à la croisée entre le soutien à l’ex-interné·e et la surveillance dont il faisait l’objet pour le contraindre à vivre de manière conforme aux normes en vigueur dans la société. En cas d’évaluation négative, la personne risquait de se faire à nouveau interner.
Se faire une place dans la société
Il arrivait souvent qu’on annonce le jour même à des personnes internées que leur mesure était levée et qu’elles allaient quitter l’institution. Du jour au lendemain, elles étaient livrées à elles-mêmes et devaient se mettre à prendre seules toutes les décisions concernant leur vie, après avoir été soumises pendant des années au bon vouloir d’autrui. Or, pendant leur internement, elles n’avaient pratiquement pas été préparées à affronter les difficultés de la vie de tous les jours. Sans compter qu’elles ne possédaient souvent rien le jour de leur libération : pas de contact avec leur famille d’origine, pas d’argent, pas de logement, pas d’amis, pas de travail, pas de perspectives. Cette problématique reste d’actualité, comme le montrent les débats sur la situation des jeunes adultes ayant passé leur enfance en institution ou dans une famille d’accueil.
De nombreuses victimes ont dû lutter des années pour trouver leur place dans la société. Elles souffraient d’un fort sentiment de rejet et de non-appartenance à la société. Souvent, elles n’avaient plus de liens avec leur entourage et peinaient à nouer de nouvelles relations. La peur d’être stigmatisées et rejetées en raison de leur passé a poussé bien des victimes à ne pas en parler. Un nombre non négligeable d’entre elles se sont réfugiées dans la drogue et l’alcool, se sont mises à vivre dans la rue et se sont à nouveau retrouvées dans le collimateur des pouvoirs publics. D’autres ont choisi le suicide.
Il était important, à la sortie de l’institution, de disposer d’un réseau de relations. Certaines victimes pouvaient compter pour cela sur le soutien de leurs parents ou d’autres proches, qui les accueillaient chez eux et leur trouvaient un premier emploi. D’autres ont fait d’heureuses connaissances ou ont trouvé sur leur voie un·e assistant·e social·e ou un·e chef·fe qui les ont aidées pour la suite de leur existence. C’est de cette façon qu’un grand nombre d’entre elles ont réussi à prendre pied dans la vie. Dans ce processus qui a souvent duré des décennies, deux éléments sont cruciaux : avoir été reconnues comme des individus dotés de capacités et s’être vu offrir une occasion de se réinsérer.